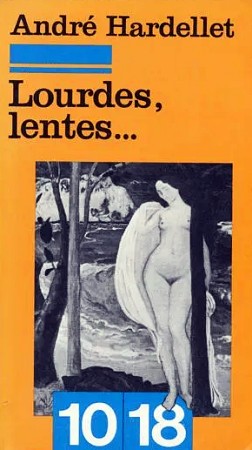
Longtemps je me suis couché de bonne heure – le matin. J’avais mes nuits ; je les ai toujours, mais sans comparaison.
Presque chaque soir, vers neuf heures, je prends un bouquin et m’allonge sur mon lit. Souvent, j’abandonne vite ma lecture ; commence alors l’étendue d’immobilité et de silence apparents où je découvre ma totale liberté. Nul guetteur sur les points culminants de la Ville noire et bleue ne se soucie du minuscule espace que j’occupe sous mon toit, rien ne me désigne à sa méfiance. Ils n’ont pas encore de machines à détecter les rêves subversifs, mais ça viendra : faisons 1eur, en ce domaine, le plus large crédit. Il me reste, je suppose, quelques bonnes années devant moi pour cet exercice de l’ombre et du secret.
Je me raconte des histoires, dont une quantité infime seulement verra le jour sur du papier. Écrire est un travail harassant : choisir, combiner les mots pour qu’ils ne s’éventent, ne pourrissent pas trop vite à la lecture ! Tâche tellement disproportionnée à nos forces que l’on se demande comment des hommes lucides ont osé l’entreprendre. Sans doute – je parle en mon nom – finissent-ils par se convaincre qu’ils aident ainsi à produire une réalité qui leur dispensera un peu de sa force, en retour. Ma pensée file, et se file, ignore toute contrainte, vire, plonge, se retourne avec l’exquise souplesse d’une loutre jouant dans l’eau. Nous avons tous du génie dans la position horizontale et les yeux clos. Quelles foulées d’une inimitable aisance sur la cendrée du sommeil ! À moi le survol des fougères d’enfance et des chemins de la terre buissonnière, dont le terme ne peut être que le cul merveilleusement énorme, consentant, d’une moissonneuse qui a sombré en bordure du bois. Ses cuisses bien écartées, la figue au soleil, mûre, juteuse, en sueur, fondue et confondue dans le rut de Messidor. Une moissonneuse de Courbet, courbe, renflée, seule, bonne comme le bon pain, tiède, profonde et qui ne dirait jamais NON.
