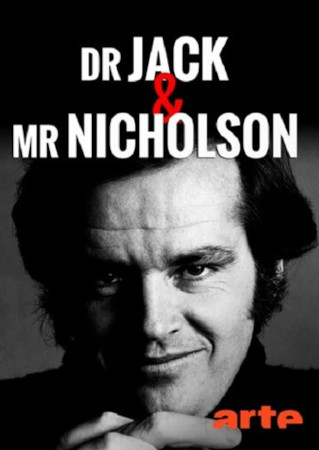
Pour le gamin du New Jersey un peu complexé qui, sur un coup de tête, décide de traverser l’Amérique à 18 ans pour fuir sa bourgade étriquée de Spring Lake et tenter sa chance à Hollywood, le cinéma sera une page blanche où chaque composition livre les éclats d’une identité qu’il semble découvrir au fil des rôles. Les débuts ne sont pas folichons : avec sa calvitie naissante, sa démarche un peu lourde, son accent traînant, il peine à trouver sa place dans l’usine à rêve des fifties. Le visage-Janus, tour à tour gendre idéal ou bad boy renfrogné qu’il prétend être sur les photos dont il abreuve les bureaux de casting, ne lui ressemble pas. C’est Roger Corman, pape de la série B dont il va intégrer l’écurie à la fin des années 50, qui saura repérer sa singularité, cet humour décalé, un peu barge. Dans ce vivier bouillonnant, le jeune homme s’épanouit, s’essaie à l’écriture, à la réalisation et, surtout, côtoie tous les talents à venir du Nouvel Hollywood, notamment Dennis Hopper. Le petit rôle de l’avocat alcoolo qu’il lui confie dans Easy Rider (1969), où le génie fêlé de Nicholson éclate, le propulse instantanément au rang de star. L’attraction hypnotique qu’il confère à chacune de ses apparitions à l’écran fait dès lors écho à l’irrésistible pouvoir qu’il exerce sur la gent féminine. Instable, insatiable et jouisseur compulsif, Nicholson semble avoir une revanche à prendre et le cinéma lui permet de réparer la blessure d’une enfance sans père et d’exorciser le lourd passé qu’à son insu il traîne. — Nathalie Dray
